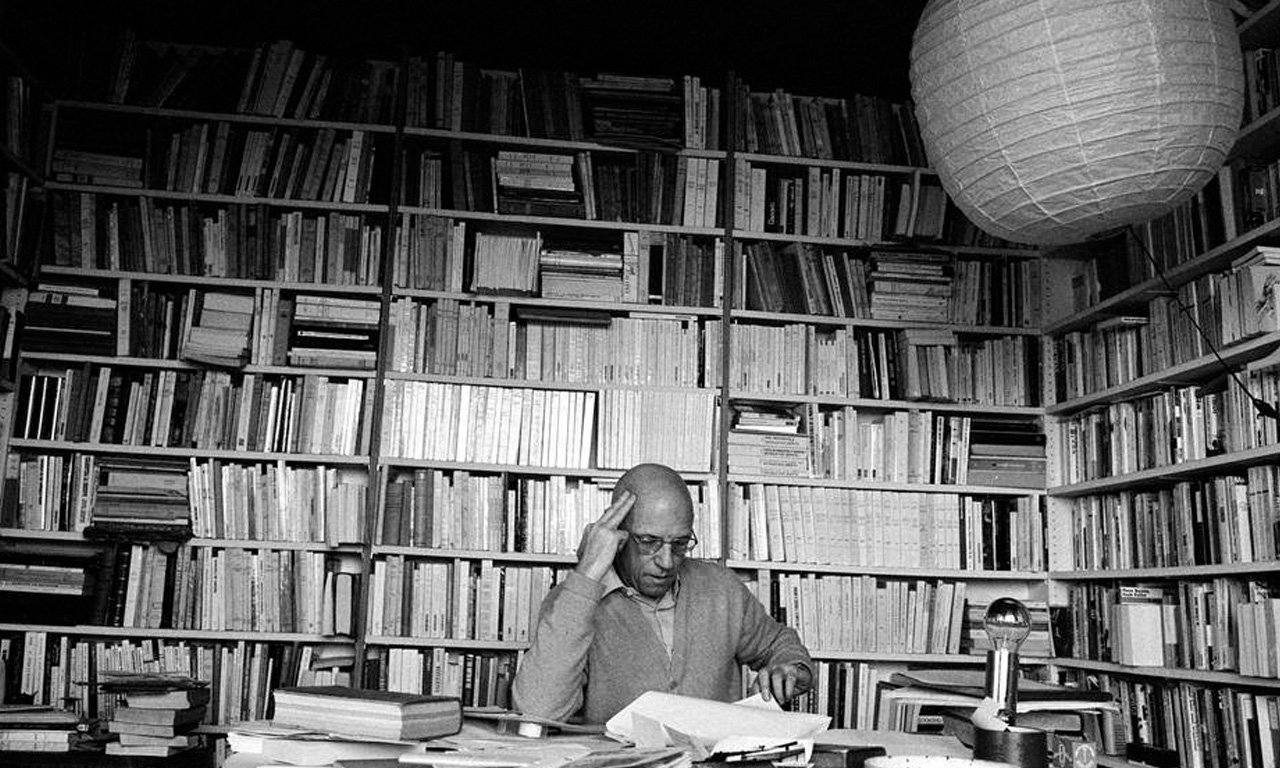Journal du confinement (9)
J’avais la tête pleines de mots avant de me poser devant l’ordinateur avec une tasse de thé. Ils se sont envolés. Remplacés par le stress à l’idée de ce que j’ai à faire d’ici deux semaines. Ecrire est inutile, cela ne rapporte rien. A quoi bon s’ingénier à jouer à l’auteur dans un monde futur où disparaîtront les librairies et les maisons d’édition ? Ai-je vraiment l’opportunité de devenir écrivain ? Ces questions me taraudent. Six semaines d’un temps infini ne m’auront pas permis d’avancer mon roman. La prégnance de l’épidémie emporte le récit vers des rivages morbides et mortifères. Je ne contrôle plus rien. Je sais que cet abandon est provisoire, que j’ai profité de cette période pour me frotter autrement à des lecteurs par centaines. Je n’arrive pourtant pas à me détacher d’un sentiment de culpabilité : qu’ai-je fait du temps qui m’a été offert ? N’ai-je donc pas une nouvelle fois tout gâché ? Vais-je laisser tomber et passer à autre chose ? Oublier cette ancienne lubie et retourner à ce qui me fait vivre ?
Le souvenir est lointain. Probablement inexact. Je viens d’avoir 18 ans. J’essaie de m’endormir sur la plage de Camaret car je n’ai pas osé chercher une chambre d’hôtel. Je me suis engueulé violemment avec mon père qui m’a reproché de foutre en l’air mes études et de ne pas avoir la tête sur les épaules. J’étais bien gentil avec mes grandes idées mais elles ne font pas bouillir la marmite. Quel dédain j’avais alors pour le métier de mes parents « petits commerçants » ! Leur tord aura été de vouloir me protéger et de ne pas m’apprendre ce qu’était réellement leur métier. Depuis 30 ans, j’ai volontairement sabordé tout ce que j’ai entrepris : mes études d’abord, jamais terminées, mes projets de sites internet, abandonnés sur l’autel du pragmatisme financier qui me conduisait à privilégier la sous traitance et les lignes de code, mon mariage, la rénovation de mon appartement, mes passions, mes amitiées. Tout y est passé ! Je suis celui qui a de bonnes idées, qui commence tout et qui ne finit rien ! Il y a toujours une bonne raison pour procrastiner. La vie a passé. Verlaine me chuchote à l’oreille :
“ Qu’as-tu fait, ô toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà,
De ta jeunesse ? ”
Vais-je continuer à me détester ? J’ai visionner récemment une vidéo dans laquelle le message se résumait simplement : “ si tu remets à demain ce que tu as à faire, c’est que tu n’aimes pas ce que tu fais ”. C’est vrai. Oui, c’est vrai. Mais pas pour tout. La terreur de l’insuccès sait être extrêmement inhibitrice. Mieux vaut couler le navire que de ne pas gagner la régate ! Le travail sur soi devient vital. Transformer peurs et fiascos en énergie nouvelle. Au fond, j’ai tant appris. On n’efface pas trois décennies de culture de l’échec en six semaines de confinement. La trouille de rater restera présente, la honte aussi. Je reste le petit garçon qui aurait souhaité plaire à ses parents. Celui dont on ne parle pas, celui pour lequel on se fait du soucis.
Hier j’ai terminé ma treizième chronique. Comme je suis un peu superstitieux, je me dépêche d’en rédiger une nouvelle. L’objectif est simple : mille mots au moins. Concentration : couper le téléphone, supprimer les notifications diverses et variées, un peu de musique, un dictionnaire des synonymes. En avant sur le grand toboggan de l’écriture ! Ecrire reste un mystère, un défit. J’envie les auteurs qui sont des mitrailleuses à mots. Ma production traîne, laborieuse. Un voile blanc obscurcit mon esprit. Les sachets de Yellow Label s’accumulent dans la poubelle, j’ai troqué la caféine contre du thé éco-responsable. Un œil par la fenêtre, la pluie a cessé de tomber. Quelle flotte depuis deux jours. Signe annonciateur de la fin de notre internement volontaire. Regretterai-je les aboiements du chien du second ? Les longs appels téléphoniques et la télévision vociférante du voisin du dessous ? Les incessantes allers et venues dans l’immeuble et la porte qui claque malgré les règles strictes du #restonscheznous ? Le rituel du professeur Salomon alignant ses chiffres lugubres chaque soir avant le journal télévisé ? Ne vais-je pas troquer une prison pour une autre, composée d’habitudes et de conventions sociales ? […]
📖 Ce texte est un extrait de mon livre PRÉLUDE.
Pour le découvrir en entier et recevoir une version dédicacée, cliquez ici.